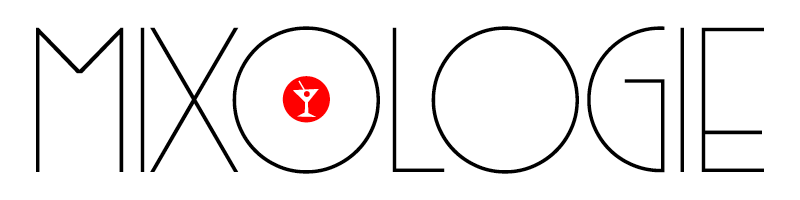La reconnaissance de cette spécificité s’est traduite par l’obtention d’une indication géographique protégée, limitant sa production aux Pays-Bas, à la Belgique et à certaines régions de France et d’Allemagne. Cette appellation strictement encadrée distingue notamment deux catégories principales : l’oude jenever, caractérisé par une proportion minimale de 15% de moutwijn et un profil organoleptique riche et complexe, souvent bonifié par un vieillissement en fûts de chêne, et le jonge jenever, dont la teneur en moutwijn oscille entre 1,5% et 15%, pour un degré alcoolique minimal de 35% et une teneur en sucre limitée à 10 grammes par litre. Cette dichotomie reflète l’évolution historique d’un spiritueux qui a su préserver ses traditions séculaires tout en s’adaptant aux goûts contemporains.
L’art séculaire du malt dans la distillation hollandaise
La production traditionnelle du jenever repose sur un processus minutieux dont le cœur est la fabrication du moutwijn, véritable signature aromatique de ce spiritueux ancestral. Cette élaboration débute par une étape cruciale de maltage, suivie d’un empâtage et d’une distillation en alambic d’un assemblage précis de céréales comprenant le « Rogge » (seigle), le « Maïs » (maïs), le « Gemoute Gerst » (orge maltée) et le « Tarwe » (blé). La maîtrise de ces différentes céréales et leur proportion dans le mélange final constituent un art complexe, transmis de génération en génération dans les distilleries traditionnelles des Pays-Bas et de Belgique.
Le processus de distillation lui-même suit un protocole rigoureux en trois étapes, utilisant des alambics en cuivre spécifiques dont la conception a été perfectionnée au fil des siècles. La première distillation, appelée « stripping run », s’effectue dans un alambic nommé « Ruwnat », suivie d’une seconde distillation dans l' »Enkelnat ». Le choix du cuivre pour ces alambics n’est pas anodin : ce métal noble possède la capacité unique d’éliminer les impuretés indésirables tout en contribuant à l’élaboration du profil aromatique distinctif du spiritueux. La troisième et dernière distillation s’effectue en alambic à colonne au sein du « Distilleerderij », où le distillat est mis en contact avec les baies de genièvre et autres botaniques selon des recettes jalousement gardées par chaque maison.
L’influence du terroir sur la production du jenever ne saurait être sous-estimée. La qualité de l’eau utilisée, comme celle de Groningen aux Pays-Bas, joue un rôle déterminant dans le profil final du spiritueux. Les variations régionales dans la composition des céréales et les techniques de distillation spécifiques à chaque région contribuent à créer des expressions uniques du jenever, reflétant la richesse et la diversité des traditions locales.
Signatures aromatiques : entre céréales et botaniques
La complexité aromatique du jenever résulte d’une alchimie subtile entre les notes céréalières issues du moutwijn et l’apport des botaniques traditionnelles. Au cœur de cette composition se trouve la baie de genièvre, botanical emblématique qui définit l’identité même du spiritueux. Cependant, contrairement au gin moderne qui peut explorer une palette quasi illimitée de botaniques, le jenever traditionnel s’appuie sur un corpus d’ingrédients historiques soigneusement sélectionnés incluant la coriandre, les clous de girofle, l’anis, le gingembre, le houblon, la racine d’angélique et la réglisse. Cette restriction volontaire aux botaniques traditionnelles garantit la préservation du caractère authentique du spiritueux.
Le processus de production unique du jenever, où certaines portions du moutwijn sont redistillées séparément avec différentes combinaisons de botaniques avant d’être assemblées selon des recettes secrètes, permet d’obtenir une complexité aromatique inégalée. Cette méthode traditionnelle crée un profil organoleptique distinctif où les notes maltées et céréalières du moutwijn s’entremêlent harmonieusement avec les nuances épicées et herbacées des botaniques. La différence fondamentale entre l’oude et le jonge jenever se manifeste particulièrement dans leur expression aromatique : l’oude jenever, avec sa proportion plus élevée de moutwijn et son possible vieillissement en fût de chêne, développe un profil plus riche et complexe, tandis que le jonge jenever offre une expression plus légère et accessible.
Renaissance mixologique : le jenever contemporain
Le renouveau actuel du jenever dans la mixologie contemporaine témoigne d’une redécouverte passionnante de ce spiritueux historique par une nouvelle génération de bartenders et d’amateurs éclairés. Cette renaissance s’exprime notamment à travers une série de cocktails innovants qui mettent en valeur la complexité aromatique unique du jenever. Le Jenever Spritz, par exemple, associe 50 ml de jenever à 100 ml de Prosecco et 50 ml d’eau gazeuse, rehaussés d’une touche de jus de citron et garnis d’une tranche de citron et d’un brin de romarin, créant ainsi une variation sophistiquée du spritz traditionnel.
Les rituels de service traditionnels continuent de jouer un rôle central dans l’expérience du jenever. La présentation dans un verre tulipe caractéristique, rempli à ras bord et préalablement refroidi, permet une appréciation optimale des arômes. La température de service, idéalement maintenue entre 4°C et 6°C, est cruciale pour préserver l’équilibre aromatique du spiritueux sans en masquer les subtilités. Cette attention méticuleuse portée au service s’inscrit dans une tradition séculaire qui encourage une dégustation lente et contemplative, permettant aux différentes couches aromatiques de se révéler progressivement.
L’innovation contemporaine se manifeste également dans la création de cocktails plus audacieux, comme le Jenever Sour, qui marie 45 ml de jenever avec 20 ml de jus de citron frais et 15 ml de sirop simple, le tout enrichi d’un blanc d’œuf pour une texture soyeuse caractéristique. Cette capacité du jenever à s’intégrer harmonieusement dans des créations modernes tout en conservant son identité distinctive témoigne de sa pertinence continue dans le paysage des spiritueux contemporains.